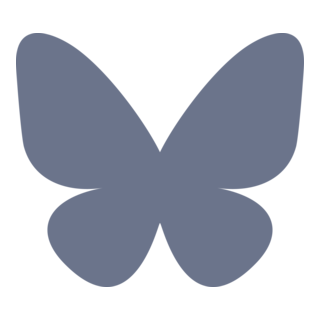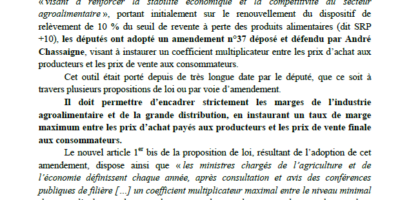S’il est une commission d’enquête qui tombe à pic pour répondre à des attentes légitimes du monde agricole et des citoyens, c’est bien celle qui fait l’objet de ce rapport à l’initiative du groupe socialiste et porté par Dominique Potier. Elle est au cœur de l’actualité, avec notamment la polémique engendrée par le renouvellement pour dix ans, par la Commission européenne, de la substance active glyphosate sans qu’il y ait un consensus scientifique issu de la recherche académique. La France s’est abstenue tout en souhaitant que soient seulement autorisés les usages pour lesquels il n’y aurait pas d’alternative. Encore faut-il que l’instruction des dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) soit suffisamment complète pour ne pas être, comme c’est de plus en plus le cas, retoquée par les tribunaux administratifs.
Les travaux de cette commission d’enquête se sont déroulés dans d’excellentes conditions malgré un contexte de tensions et controverses, en France comme en Europe, sur les effets des pesticides sur la santé humaine et la biodiversité alors que leur usage a doublé tous les dix ans entre 1945 et 1985, faisant de la France, avec 85 000 tonnes de pesticides utilisés chaque année, le premier consommateur européen et le troisième mondial.
Dans l’écriture de ce rapport, un écueil a été évité : alimenter la conflictualité.
Un objectif a été atteint : appeler à sortir de l’inaction en présentant des recommandations comme autant de moyens à mettre en œuvre.
Un risque subsiste : qu’une partie du monde agricole se considère mis en cause alors que des efforts non négligeables ont déjà été effectués.
Les constats et conclusions de cette commission d’enquête permettront, je l’espère, d’éclairer nos citoyens pris en tenaille entre les dires souvent contradictoires des experts scientifiques, le poids des lobbys de toute obédience et la pression économique imposée aux agriculteurs. Reste à mesurer l’effet de ce travail, plus particulièrement sur les orientations des organisations agricoles, sur les prises de position des partis politiques et associations environnementales, et surtout sur les décisions des pouvoirs publics.
J’appelle donc à une appropriation de ces travaux en se dégageant des a priori, postures et instrumentalisations politiciennes.
Plus particulièrement, le gouvernement prendra-t-il en compte l’urgence à mettre en œuvre un « véritable pilotage politique et stratégique de la réduction des produits phyto », comme le propose le rapport ? Aujourd’hui, l’absence de vision d’ensemble, une
gouvernance « sans pilote » et le saupoudrage d’actions révèlent une forme d’incurie de la puissance publique, ne permettant pas à notre pays d’être à la hauteur des enjeux qui n’exigent pas seulement des moyens, mais doivent conduire à des résultats probants dont le rapport fait le constat de l’insuffisance.
Aussi, nous faut-il tirer toutes les conséquences de l’échec des plans écophyto qui se sont succédés ces dix dernières années. Cela nécessite notamment, comme cela est proposé par le rapporteur, que l’objectif de réduction des produits phytosanitaires soit porté au plus haut niveau avec un pilotage confié à Matignon, le ministère de l’Agriculture étant le chef de file pour la mise en œuvre opérationnelle.
Dans cette contribution qui ne peut être exhaustive, je développerai seulement quelques éléments qui me paraissent prioritaires.
Le rapport fait apparaître, à juste raison, comme un « rendez-vous manqué » la nouvelle PAC et le PSN français. Ils ne permettent pas une mobilisation pertinente des aides publiques « pour accompagner les premiers acteurs de la transition écologique que sont les agriculteurs ». L’appréciation est d’autant plus sévère que l’ambition environnementale portée par la PAC au niveau européen se trouve, selon le rapport, « minorée dans sa déclinaison française au sein du PSN », la France ayant « fait le choix d’une programmation accessible au plus grand nombre au détriment d’une ambition environnementale plus élevée ». Cela apparaît en premier lieu sur le manque d’exigences pour accéder aux éco-régimes, qui fait que « 100 % des exploitations agricoles atteignent le niveau 1 de l’éco-régime sans fournir aucun effort et 85 % le niveau deux de la même façon ». Pis encore, « si un exploitant n’est pas au niveau sur l’usage des pesticides, il lui reste d’autres voies d’accès à l’éco-régime ».
Cette situation est aggravée d’une part par une conditionnalité des aides directes du premier pilier avec des critères insuffisants en termes de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, d’autre part par l’insuffisance des budgets consacrés aux
MAEC, mais aussi par la faiblesse des aides à la conversion en agriculture biologique. La loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, prévoyait d’atteindre 20 % de la Surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique en 2020. Sur fond de suppression des aides au maintien, nous en sommes toujours aujourd’hui à 8 %, malgré le plan Ambition Bio 2018-2022 qui fixait un objectif de 15 % de la SAU en 2022. Tout engage donc à réformer le PSN français avec la série de propositions que développe le rapporteur.
À cette situation s’ajoute la distorsion de concurrence qui défavorise les producteurs qui adoptent des pratiques vertueuses. En effet, des produits sont importés sans respecter les normes phytosanitaires européennes au regard de l’insuffisance des contrôles, tant sur les critères employés que sur leur ampleur. De plus, la charge de la preuve n’incombe pas au fournisseur, mais relève du contrôle du respect de la réglementation à l’entrée des produits sur le territoire de l’Union européenne. Quant à la clause de sauvegarde qui permet de bloquer l’entrée d’un produit sur le territoire de l’UE, elle n’est que rarement utilisée et, quoi qu’il en soit, elle ne peut être que transitoire dans l’attente de règles strictes et opérationnelles sur les clauses miroirs dont l’application concrète reste aujourd’hui un simple miroir aux alouettes. Des mesures précises sont proposées par le rapporteur pour remédier à cette situation. Elles ont mon approbation.
Il aurait pu cependant être opportun de faire un rapprochement entre l’exigence d’un plan d’action contre le réchauffement climatique, avec notamment la capacité des sols à capter le carbone, et celle de faire évoluer les pratiques agricoles pour maîtriser l’impact des produits phytosanitaires sur la santé humaine et environnementale. Cette double exigence nécessite de reconcevoir en profondeur les systèmes de production agricole pour répondre aux besoins alimentaires en quantité et qualité tout en limitant les effets négatifs des pratiques de production.
À titre d’exemple, certaines pratiques agricoles comme l’agriculture dite « de conservation », de « régénération » ou « du vivant » attachent une importance prépondérante à l’amélioration de la fertilité des sols, avec le maintien de couverts végétaux permanents et la limitation stricte, voire l’absence, de travail du sol. Les apports indéniables de ces modèles portent à la fois sur des critères environnementaux et agronomiques : stockage de carbone et amélioration des taux de matière organique, limitation de l’érosion, amélioration de la réserve utile en eau des sols et de leur fonctionnement biologique, préservation de la biodiversité, limitation des apports d’engrais minéraux, baisse des charges de mécanisation et d’irrigation… Pour autant, la grande majorité des exploitants engagés sur ces modèles soulignent le besoin de maintenir parallèlement, même à des doses limitées, l’usage d’herbicides, de fongicides ou d’insecticides dans leurs itinéraires techniques.
Il est selon moi extrêmement important de pouvoir dégager pour ces modèles vertueux sur le plan environnemental et agronomique une évaluation scientifique claire de leurs bénéfices et inconvénients, afin de définir des politiques publiques éclairées et adaptées, comprenant des dispositifs de soutiens spécifiques, ainsi qu’une valorisation économique de ces productions.
De la même façon, l’agriculture biologique, qui restreint strictement l’utilisation des produits chimiques de synthèse et limite le recours aux intrants dans son cahier des charges, doit pouvoir bénéficier de soutiens spécifiques non seulement à la conversion, mais aussi au maintien et à l’accompagnement. Ces soutiens sont d’autant plus nécessaires que cette agriculture connaît aujourd’hui une crise sans précédent en lien avec l’érosion du pouvoir d’achat d’une majorité de la population.
Enfin, un levier essentiel de la transformation des pratiques pour faire baisser l’usage des produits phytosanitaires est l’indispensable déspécialisation des territoires agricoles. La spécialisation et la concentration régionale des productions – dynamiques toujours à l’œuvre aujourd’hui ! — ont engendré de graves déséquilibres dans le fonctionnement des agrosystèmes, qu’il s’agisse des régions céréalières ou des zones de forte concentration de productions animales comme l’Ouest de la France. Cette situation résulte de soixante-dix ans d’évolutions agraires marquées par la chimisation, la grande motomécanisation et une sélection génétique pour atteindre le maximum de rendement avec en ligne de mire la mise en concurrence des agricultures sur des marchés mondialisés.
Incités par les politiques agricoles et de marché, les agriculteurs se sont détournés des grands principes de l’agroécologie reposant sur les complémentarités entre productions animales et végétales. En effet, le fumier produit par les animaux amende et fertilise la terre avec un rapport carbone/azote très intéressant. En retour, les cultures sont pour partie destinées à l’alimentation des animaux d’élevage, dont les déjections iront de nouveau sur les cultures. C’est ce type de relations circulaires qui caractérisaient les
agroécosystèmes des années 1950 où l’on retrouvait sur la même exploitation agricole différentes productions animales et plusieurs espèces végétales. En basant la reproduction de la fertilité de la terre sur l’incorporation de fumier, la polyculture-élevage permettait de
réduire les émissions de protoxyde d’azote engendrées par la fertilisation minérale, tout comme celles de dioxyde de carbone liées à la fabrication des engrais. L’introduction de cultures fourragères dans les rotations — type prairies temporaires d’association graminées/légumineuses — contribue à allonger les rotations, donc à limiter la concurrence des adventices et la pression des pathogènes et ravageurs des cultures. Ainsi, les quantités de produits phytosanitaires peuvent être considérablement amoindries. Ces
systèmes de production diversifiés peuvent permettre également de lisser les risques et de ne pas « mettre tous ses œufs dans le même panier » en cas d’aléa climatique, sanitaire ou économique sur une production donnée.
De nombreux travaux de recherche soulignent que les modèles de polyculture/élevage, d’une très grande diversité, sont nécessaires pour assurer la transformation agroécologique et pour faire baisser notre dépendance aux produits phytosanitaires. Ils doivent être, là aussi, bien mieux pris en compte, et surtout, déboucher sur des politiques publiques cohérentes et à la hauteur, même s’ils impliquent des réorientations très profondes des soutiens et des agrosystèmes français et européens.
Au fond, en matière d’utilisation des produits phytosanitaires, nous ne saurions en rabattre sur nos ambitions ni favoriser, comme le veut le gouvernement, une forme de statu quo européen. Il s’agit au contraire de nous donner les moyens de protéger notre agriculture des logiques mortifères de la mondialisation libérale. Cet objectif nécessite d’accélérer la transition agroécologique en accompagnant techniquement et financièrement les agriculteurs, en soutenant les programmes de recherche de l’Inrae, en développant des formations… tout en garantissant du même mouvement des revenus décents à nos paysans.
Accéder à l’intégralité du rapport de la commission d’enquête parlementaire ici.
Voir aussi sur le même sujet